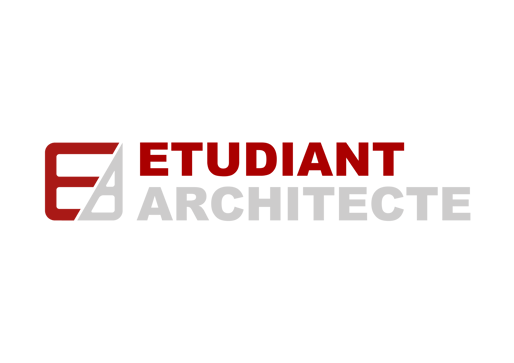Fiche lecture n°02 : Gilles Dautun - La vie rurale mode d'emploi
Tu t'intéresse à un livre en particulier ou cherche simplement à découvrir de nouveaux ouvrages ? Chaque mois retrouve une fiche lecture en lien avec l'architecture !
MÉDIATHÈQUE
Louis T.
2/8/20225 min read
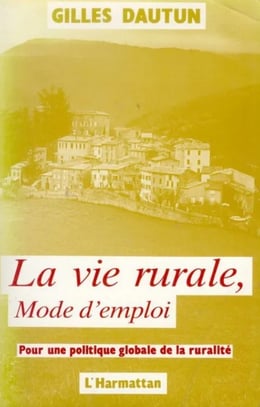
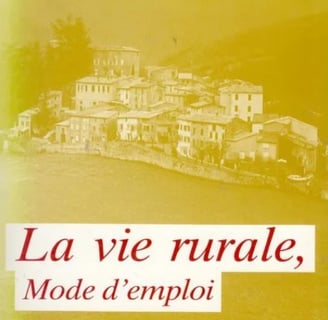
I. Fiche d'identité
Auteur : DAUTUN Gilles
Titre : La vie rurale, mode d’emploi
Édition : L’Harmattan, Paris, 1992, 445 pages.
Structure : préface, «Qu’est ce que la ruralité», avertissement, avant-propos, table des matières, 25 chapitres en 5 parties, conclusion, annexes («quelques pistes pour les gens pressés» et 23 illustrations).
II. Compte-rendu de l'ouvrage
Avertissement : Dans cette première partie Gilles Dautun explique le but de son ouvrage ainsi que l’origine de celui-ci. On apprend qu’il souhaite apporter un ensemble de propositions aux décideurs administratifs (au nombre de 101). Cela avec pour volonté de remettre l’espace rural à sa place, c’est-à-dire lui redonner une place centrale au même niveau que l’espace urbain et ne pas le réduire à un adjuvant des villes.
Selon lui, le fait que chaque ministère gère une partie de la ruralité est une parfaite illustration de l’importance attachée à la ruralité. Les mesures qu’il propose doivent être entendues dans leur ensemble, la globalité à laquelle il se rapporte dans le titre de son livre doit être comprise pour pouvoir parler d’une véritable ruralité.
Avant-propos : L’auteur raconte au travers d’une anecdote sur un voyage en Lozère comment il en est arrivé à travailler sur la ruralité. Cela lui est venu simplement en parcourant l’espace rural et en s’y attachant. On apprend qu’il a par la suite passé 25 ans à étudier ce sujet.
Première partie : Gilles Dautun commence son ouvrage par un ensemble de propositions et de constats sur l’importance et la manière de générer une dynamique rurale. Il explique qu’enrayer le déclin du monde rural est possible seulement à l’aide d’une dynamique de qualité. Selon lui celle-ci doit passer par la mise en place d’une politique des villages. Cette dernière doit faire en sorte d’enrayer la fuite des jeunes générations tout en intégrant les «anciens».
Par ailleurs, d’autres facteurs sont à ses yeux importants notamment la volonté de réaliser des projets ambitieux en zone rurale qui permettraient de booster la créativité et auraient valeur d’exemple (p.53), le développement de l’exigence de la qualité des productions locales, l’inscription des programmes sur des territoires cohérents et homogènes pour stimuler la solidarité ainsi que l’exportation des produits du patrimoine pour ne plus avoir à les vendre. Il pense que cette dynamique passe par la valorisation et la mise en avant des villages qui ne se résignent pas, qui font preuve de dynamisme et d’ambitions.
Il illustre son propos en partageant de nombreux exemples à l’image du village de Laguiole (p. 66) qui a su se réapproprier un passé coutelier important en le remettant en avant dans le but de redynamiser le village et ses alentours.
Deuxième partie : Cette partie est l’occasion pour l’auteur d’aborder la question de la valorisation de l’espace rural. Il le décrit comme un milieu au sein duquel les actions mises en oeuvres doivent être réfléchies. Il pense qu’il faut cesser de raisonner en terme de démographie à leur de prendre des décisions influençant ces zones mais plutôt en terme d’économie harmonieuse de l’espace. Autrement dit valoriser ce dernier en le respectant.
Pour cela il est nécessaire selon lui de reconnaître la ruralité dans sa globalité, de faire des agriculteurs le pivot de la ruralité, de bien distinguer l’environnement rural de l’environnement urbain, d’orienter le tourisme rural vers de la qualité, de placer la culture au centre du développement rural ainsi que d’intégrer et reconnaître le commerce, l’artisanat et les activités tertiaires.
Il explique que la recherche de la qualité et de l’intégration au milieu permet de respecter l’espace et donc de le valoriser (p. 88).
Troisième partie : Dans la troisième partie de ce manifeste Gilles Dautun explique l’importance du choix des outils liés au développement et à l’aménagement rural. Il en cite et décrit plusieurs comme l’adaptation et la souplesse des services publics et privés qui consisterait à distinguer les services de base et ceux plus complémentaires pour maintenir les services de base comme les gendarmeries, services scolaires et postaux, et permettre une plus grande souplesse dans les choix politiques respectifs aux services complémentaires.
La stratégie et la cohérence sont aussi des outils fondamentaux à ses yeux. La cohérence implique la recherche, et la stratégie, la durée. C’est le manque de ces deux éléments qui entrainerait en plus de surcoûts élevés, l’échec des projets et donc la réduction des actions (p. 180).
Il prône le fait que la mise en place d’une politique globale de la ruralité supprimerait les incohérences. L’inscription des projets dans une stratégie à plusieurs échelles supprimerait l’isolement et donc réduirait la fragilité de ceux-ci. Une des principale limite à ces deux facteurs de réussite serait le cloisonnement entre les différents acteurs publics et secteurs d’activité.
Quatrième et cinquième parties : l'auteur clôture l’ouvrage en s’attachant à l’évolution des structures politiques et la communication liée à ces politiques. Aujourd’hui, ces structures ont pour la plupart évoluée ce qui illustre la pensée de Dautun. Ce dernier explique qu’une politique rurale globale passe par des structures de qualité et donc qu’il faut justement arrêter de vouloir être conservateur et ne pas hésiter à les faire évoluer, à favoriser des regroupements ou encore suggérer certaines suppressions si cela est nécessaire.
Il est aussi primordiale selon lui d’intégrer la communication à l’action. C’est faire connaître de manière claire et rapide les mesures prises en matière de développement et d’aménagement rural. Il rappel le rôle des médias, locaux ou non dans l’accès à l’information des populations et la création d’une image du monde rural.
Conclusion : Gilles Dautun dans cet ouvrage cherche à faire prendre conscience au lecteur le potentiel du monde rural français ainsi que la fragilité sur laquelle il repose. Il utilise la figure de style de la comparaison pour soulever la question de l’avenir de la ruralité.
Construite comme la maison du facteur cheval, la ruralité doit-elle rester ainsi et souffrir potentiellement de ruine ou doit-elle devenir le nouveau Palais du Louvre ?
"L’espace rural est un milieu dans lequel on ne peut plus faire n’importe quoi"
Gilles Dautun
II. Avis sur l'ouvrage
Un livre très engagé, dans lequel Gilles Dautun tente de démontrer qu’une politique globale de la ruralité est possible et souhaitable. Il essaie d’apporter des réponses aux principaux enjeux liés à la ruralité en s’appuyant sur un travail d’immersion, ce qui appuie son propos théorique.
La lecture est facilitée grâce aux nombreuses sous-parties et à la variation régulière de la typographie pour mettre en avant les principales idées. Bien que datant de 1992, cet ouvrage a très peu vieilli, il soulève des questions qui sont aujourd’hui encore d’actualité.
Le manifeste de Dautun est une sorte de bouteille à la mer dans laquelle serait glissé un message d’espoir. Pour revaloriser la ruralité il faut agir. Agir rapidement. Agir avec sens et conviction.
Cette lecture permet de mieux comprendre les problématiques auxquelles sont confrontés les zones rurales françaises.
Si tu souhaites donner ton avis sur l'ouvrage ou si tu as simplement aimé cette fiche lecture n’hésite pas à le partager et le faire savoir en commentaire.
Retrouve chaque mois une nouvelle fiche lecture. Abonne-toi à la newsletter en bas de cette page pour être tenu(e) informé(e) en priorité de sa sortie ! 👇
Etudiant Architecte
Blog conseils et ressources dédiés aux étudiants en architecture.
Contact
BENEFICIE DE -10% sur l'ensemble de la boutique en t'inscrivant a la newsletter
POUR DECOUVRIR EN AVANT PREMIERE LES NOUVEAUX ARTICLES C'EST ICI 👇
contact@etudiantarchitecte.fr
CGV CGU Politique de confidentialité © 2024. All rights reserved.