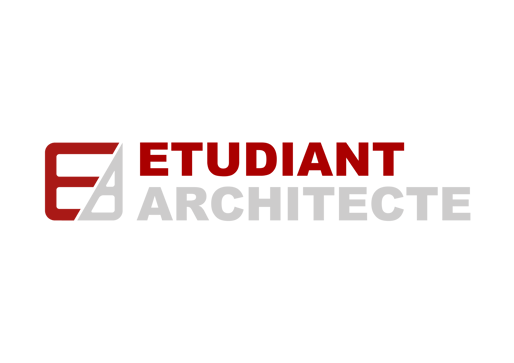Fiche lecture n°01 : Alain Roger - Court traité du paysage
Tu t'intéresses à un livre en particulier ou cherches simplement à découvrir de nouveaux ouvrages ? Chaque mois retrouve une fiche lecture en lien avec l'architecture !
MÉDIATHÈQUE
Louis T.
3/7/20234 min read


I. Fiche d'identité
Auteur : ROGER Alain
Titre : Court traité du paysage
Édition : Folio Essais, Gallimard, Paris, 1997, 256 pages.
Structure : avant-propos, 9 chapitres en 4 parties, 25 illustrations, épilogue, 2 appendices, notes, index des auteurs et artistes cités, table des matières.
II. Compte-rendu de l'ouvrage
Avant-propos : Dans cette première partie Alain Roger décrit le type d’ouvrage qu’il a voulu écrire et dans quel but. Il explique qu’il manquait des écrits traitant de manière complète la question du paysage. Son livre se veut « discret et maniable ». Il décrit par ailleurs en quelques lignes sa vision personnelle du paysage qu’il va expliciter dans son traité, une vision humaine et artistique.
Première partie : Dans les premiers chapitres, Alain Roger explique que l’art est déjà une perception de la nature car une oeuvre fait intervenir un artiste qui lui-même interprète la nature. Il cite Oscar Wilde et sa « révolution copernicienne de l’esthétisme» pour démontrer que l’artiste à un rôle principal dans la construction du paysage, il le créé. Il donne à voir des choses auxquelles nous n’aurions pas prêté attention sans leur mise en valeur par une oeuvre d’art. Alain Roger emploie l’expression « double artialisation » (p. 22) in visu pour expliquer que le paysage est la perception esthétique d’un pays. In situ pour prouver qu’un jardin ou toute autre intervention de land art est la création directe d’un paysage.
Il aborde la question de l’importance des lieux dans sa construction. Des lieux puissants, singuliers créent de multiples paysages de part les légendes et le nombre de personnes qui s’y intéressent (ex du Mont-Fuji au Japon). Par ailleurs des lieux plus communs ne retiennent pas l’attention des gens et ne sont donc au départ pas liés à cette notion de paysage (ex de la Sainte Victoire mise en lumière grâce à Cézanne).
L’écrivain explique l’importance du rapport entre les personnes et le territoire. Des habitants qui connaissent leur pays ne comprendront pas forcément en quoi certaines personnes y voient des paysages et donc un certain esthétisme alors que quelqu’un qui découvre ce même environnement pourra les percevoir de manière évidente.
Deuxième partie : Dans la seconde partie du traité, Alain Roger en vient à aborder la naissance du concept de paysage. Il explique que c’est une notion qui arrive en occident au XVème siècle par des peintres de pays du nord (Dürer en 1490) tels que l’Allemagne ou les Pays-Bas. Ces derniers concevaient leurs œuvres en plaçant le sujet de manière inséparable avec leur environnement, ce qui donna les premières peintures paysagères.
Il défini deux principes fondamentaux intrinsèques à l’invention du paysage : la laïcisation des éléments naturels et leur organisation en groupes autonomes (p. 79). Il y a selon lui une évolution constante de ce qui devient paysage, de nouveaux sont mis en avant régulièrement, par exemple le paysage a très longtemps été seulement campagnard puis a évolué au cours du temps pour inclure les paysages montagneux, puis marins ou encore plus récemment désertiques. Les personnes dans leur quête d’émotions et de moments uniques s’intéressent de plus en plus à des paysages dont l’esthétisme doit sans cesse s’améliorer, ce qui fait qu’aujourd’hui les paysages doivent plus simplement être beaux mais sublimes et donc uniques.
Alain Roger explique que les voyages ainsi que l’environnement dans lequel on vit a beaucoup amené ces changements dans notre perception et notre création des paysages. Il pense que ces évolutions peuvent entraîner la mort de certains d’entre eux (p. 123). Une mort in situ amenée par une détérioration direct (volonté de l’améliorer, fréquentation trop importante,...)ou in visu traduite par une banalisation (production de visuels trop importante, artialisation pour plaire,...).
Les ultimes chapitres sont l’occasion de porter une réflexion sur le rôle des sociétés dans la préservations et la création des paysages. Il manifeste pour l’acceptation des nouveaux paysages créés de manière involontaire ou irréfléchie, absent d’esthétisme, selon le point de vue général (TGV, autoroutes,...). Il met en avant le fait que la notion de paysage n’occupe pas une place suffisamment importante dans l’esprit collectif lors de prises de décisions (p.143).
Dans le dernier chapitre, Alain Roger tente d’apporter comme il le décrit une touche « ludique » à son traité en se questionnant sur le fait qu’un paysage puisse être érotique ou non. Il résume bien sa pensée sur le paysage : « notre perception esthétique de la nature est toujours médiatisée par une opération artistique».
Il utilise ensuite divers exemples artistiques pour suggérer que la femme serait liée au paysage et l’homme aux personnes (p. 185). Ce chapitre est l’occasion de démontrer qu’un paysage peut se construire de manière très variée.
Epilogue : Un épilogue est présent pour exposer les raisons qui ont amené Alain Roger à écrire sur le paysage. Il explique que cela est dû à un concours de circonstances. Son intérêt pour le paysage fût à l’origine littéraire, au travers de l’écriture de romans. Puis il s’intéressa aux questions d’esthétisme suite à la rédaction simultanée du roman Le voyeur ivre et de sa thèse d’Etat (p. 202).
"Un paysage n'est jamais naturel mais toujours culturel"
Alain Roger
III. Avis sur l'ouvrage
Un livre riche, clair et synthétique. Alain Roger s’attache à parler du paysage de manière théorique sans vulgarisation ou raccourcis. L’ouvrage étant fragmenté en neuf chapitres, cela permet de bien suivre sa pensée. Il aborde le paysage, sa naissance et sa construction au travers de différentes thématiques (environnement, histoire,...) et s’attache à citer de nombreuses sources pour argumenter son propos.
Il est important de bien remettre ce livre dans son contexte (écrit à la fin du XXème), aujourd’hui avec la mondialisation à outrance ainsi que les réseaux sociaux (qui n’existaient pas à l’époque), la notion de paysage s’en retrouve quelque peu bouleversée.
Pour acheter ce livre c'est ici ! (ton achat via ce lien permet de soutenir le blog 🙏)
Si tu souhaites donner ton avis sur l'ouvrage ou si tu as simplement aimé cette fiche lecture n’hésite pas à le partager et le faire savoir en commentaire.
Retrouve chaque mois une nouvelle fiche lecture. Abonne-toi à la newsletter pour être tenu informé en priorité de sa sortie ! 👇
Etudiant Architecte
Blog conseils et ressources dédiés aux étudiants en architecture.
Contact
BENEFICIE DE -10% sur l'ensemble de la boutique en t'inscrivant a la newsletter
POUR DECOUVRIR EN AVANT PREMIERE LES NOUVEAUX ARTICLES C'EST ICI 👇
contact@etudiantarchitecte.fr
CGV CGU Politique de confidentialité © 2024. All rights reserved.